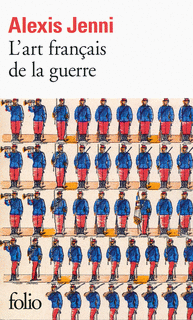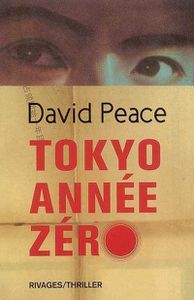Entrer dans Kafka sur le rivage, c'est entrer dans la puissance de l'imaginaire, dans les méandres de l'inconscient, dans les délices de la fiction, c'est plonger avec un enthousiasme rare dans un univers aussi prenant que séduisant intellectuellement.
On ose parler d'un des plus grands romans du XXe siècle. Vous savez, de ces pavés légers, que vous dévorez en quelques traits - et puis quand vous arrivez dans la dernière centaine de pages, vous avez envie de faire traîner votre lecture, pour ne pas en finir.
Le jeune narrateur vit à Tokyo, dans l'arrondissement de Nakano, seul avec son père car sa mère les a quittés quand il avait 4 ans, emmenant sa soeur avec elle. Le jour de ses quinze ans, il fugue. Le hasard (mais peut-on parler de hasard, dans ce roman où tout semble régi par des forces mystérieuses ?) le conduit sur une île, dans le Shikoku. Il n'emporte avec lui que quelques affaires, beaucoup de courage, et le poids de la "prédiction", sorte de fatalité oedipienne prononcée un jour par son père, et dont il tentera de s'affranchir, tout en sachant bien, du haut de ses quinze ans, que la distance ne peut résoudre tous les problèmes.
Lecture, sport, emplissent ces journées de liberté, dans un rythme qu'il se plaît à maîtriser, dans une régularité où il semble trouver son équilibre.
Mais un jour, il perd connaissance, et se réveille dans un parc, ensanglanté. N'ayant aucune mémoire des quelques heures qui viennent de s'écouler, il comprend, en voyant qu'il n'est blessé nulle part, que ce sang ne peut être le sien - et que sans doute c'est un sang qu'il a fait couler.
Aurait-il commis un crime ?
... D'autant qu'il apprendra que son père s'est fait assassiner.
Toujours est-il qu'il doit encore plus à présent éviter les forces de l'ordre, ne pas se faire remarquer.
Il trouve refuge chez Sakura, une jeune fille rencontrée dans le car.
Une jeune fille qui a l'âge d'être cette soeur qu'il n'a connu que très jeune.
Et une jeune fille qui le fait dormir dans son lit, envers qui il éprouvera un désir bien naturel.
Il s'enfuit, donc, loin de la tentation de la chair avec celle qui pourrait être sa parente. Et trouve refuge cette fois, pour un certain temps, dans une bibliothèque privée, particulièrement accueillante, où officient le jeune Oshima et la directrice, Mlle Saeki, belle femme cinquantenaire élégante et un peu mystérieuse.... Femme qui aurait l'âge d'être sa mère. Et vers qui il a l'impression que son destin l'a conduit, irrémédiablement. Il construira, en même temps qu'un amour profond envers cette femme, une hypothèse que rien ne vient contrer : cette femme serait sa mère.
Le rêve, l'étrange, le désir et le réel se mélangent. Voici le jeune Kafka (c'est le pseudonyme qu'il s'est choisi pour sa nouvelle vie de fugueur) potentiellement assassin de son père, amant de sa mère, violeur de sa soeur. Telles étaient précisément les trois volets de la prédiction prononcée par son père.
Jusqu'où faudra-t-il fuir encore pour échapper à ce destin ? Au fin fond d'une forêt ? A la lisière de la mort ? de la folie ?
En parallèle de ce récit, on découvre également au fil des chapitres l’histoire de Nakata. Nakata est un vieil home qui, après un accident étrange, a perdu la plupart de ses facultés intellectuelles. Il vit d'une pension pour handicapés, et de son don de parler avec les chats qui lui permet de retrouver les compagnons à quatre pattes quand ils se sont un peu trop éloignés de leur famille d'accueil. Nakata ne réfléchit pas, ne s’ennuie jamais, mais obéit à un instinct, des forces obscures, qui feront de lui le sujet de scènes plus extraordinaires les unes que les autres, et le conduiront dans un périple de Tokyo à Shikoku – sur les traces de Kafka, sans le savoir… jusqu’à cette mystérieuse et accueillante bibliothèque privée.
Non, rassurez-vous, nous n’avons pas tout dévoilé de ce roman incroyablement rythmé qui, aussi grave qu’ils puisse être dans certains passage, n’en flirte pas moins avec le loufoque, le fantastique, et réserve à son lecteur quantité de surprises.
A vous de les découvrir, dans cette élégante version poche, de la collection 10 18 qui a fait peau neuve récemment. Vous nous expliquerez, tiens, pourquoi ce choix, en couverture, d’une tête de chat sous une pluie de petits poissons.
10/18, 638 pages, 9,60 euros.
Traduit du japonais par Corinne Atlan.